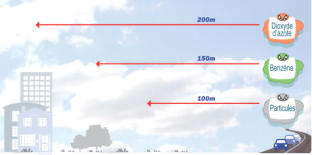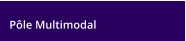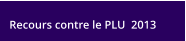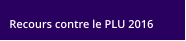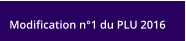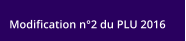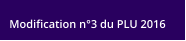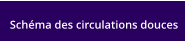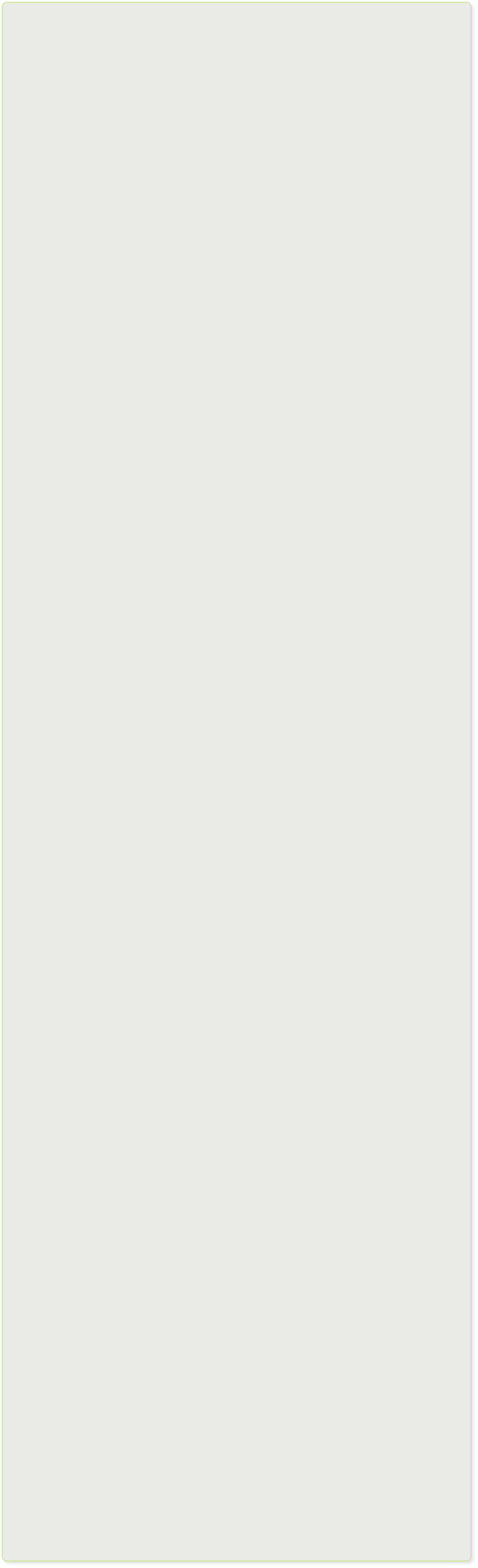
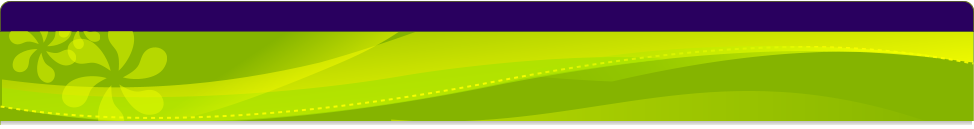

LA POLLUTION DE L’AIR
Introduction
La
pollution
de
l’air
ne
se
voit
pas
et
généralement
ne
se
sent
pas.
Elle
a
pourtant
de
graves
répercussions
sur
la
santé.
La qualité de l’air est un enjeu de santé publique.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de l’air, en milieu urbain, accroît le risque de maladies
respiratoires aiguës (pneumonie …) et chroniques (cancer du poumon …) ainsi que de maladies cardio-vasculaires. Pour
plus de détails :
https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair
Santé
Publique
France
(ANSP)
estime
que
la
pollution
par
les
particules
fines
(PM2,5
de
taille
inférieure
à
2,5
micromètres)
émises
par
les
activités
humaines
est
à
l’origine
chaque
année,
en
France
continentale,
d’au
moins
4
8
0
00
décès prématurés par an
et à
une perte d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans.
Selon
un
rapport
de
Airparif,
une
part
importante
de
la
pollution
de
l’air
est
due
aux
moteurs
thermiques
des
véhicules.
Parmi
les
polluants,
il
faut
citer
l
e
dioxyde
d’azote
(NO2)
qui
entraîne
une
i
nflammation
des
voies
respiratoires
,
ce
qui
peut préparer le terrain aux virus.
Le
n°
39
de
Airparif
Actualité
de
décembre
2012
montre
que
la
pollution
est
maximale
sur
les
axes
routiers
puis
décroit
progressivement.
Ci-dessous,
un
extrait
de
la
page
3
qui
schématise
la
diffusion
maximale
de
3
polluants
dans
le
cas
d’un
axe
routier
majeur.
Pour
un
axe
plus
modeste,
la
distance
d’impact
est
de
l’ordre
de
50
à
100
mètres
selon
les
polluants
et
l’intensité
du trafic.
Situation en Île-de-France
Cette pollution ne date pas d’hier comme le montrent les articles du Parisien et du Républicain de 1997 et 1995 : c’est la pollution atmosphérique
chronique qui diminue l’espérance de vie.
Dans
le
bilan
2015
de
la
qualité
de
l’air
en
Île-de-France,
Airparif
écrivait
:
Ce
sont
les
Franciliens
résidant
dans
l'agglomération
parisienne
et
le
long
du
trafic
qui sont les plus concernés : au voisinage de certains grands axes la pollution est jusqu’à deux fois supérieure aux normes annuelles.
Dans le bilan 2019
publié le 2 juin 2020, on pouvait lire :
«
À
l’exception
de
l’ozone,
la
baisse
tendancielle
des
niveaux
de
pollution
chronique
se
poursuit
et
l'intensité
de
dépassement
des
normes
se
réduit
d’année
en
année.
Les
recommandations de l'OMS sont néanmoins largement dépassées notamment pour les PM
2,5
».
Plus récemment, un article du Huffpost du 26 janvier 2021 intitulé « Combien de morts devrons-nous encore déplorer à cause de la pollution automobile avant de
changer radicalement de modèle ? » cite le chiffre de 2575 décès prématurés par an à Paris.
Situation en France
Selon le ministère de la transition écologique, la qualité de l’air extérieur en France en 2019 s’améliore. « Toutefois, des dépassements des seuils
réglementaires … persistent … . Ils concernent plus particulièrement l’ozone et le dioxyde d’azote, principalement à proximité du trafic routier en ce qui concerne le dioxyde
d’azote ». Plus de détails sur https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-de-la-qualite-de-lair-exterieur-en-france-en-2019
Mais
il
ne
s’améliore
pas
suffisamment
vite.
Le
17
mai
2018,
la
Commission
européenne
a
décidé
de
renvoyer
la
France
devant
la
Cour
de
justice
de
l’Union
européenne
(CJUE)
et
celle-ci,
dans
un
arrêt
rendu
le
24
octobre
2019,
a
condamné
la
France
pour
son
incapacité
à
protéger
ses
citoyens
contre
la
pollution
de
l’air.
La
CJUE
estime
que
«
la
France
a
dépassé
de
manière
systématique
et
persistante
la
valeur
limite
annuelle
pour
le
dioxyde
d’azote
depuis
le
1
er
janvier
2010
»
.
Le
dioxyde
d’azote
(NO
2
),
est
un
gaz
toxique
émis
principalement
par
le
trafic
routier
qui,
en
outre,
contribue
à
la
formation de l’ozone sous l’action du rayonnement ultraviolet.
Législation et réglementation
La
loi
LAURE
du
30
décembre
1996
(Loi
sur
l’Air
et
l’Utilisation
Rationnelle
de
l’Energie)
avait
reconnu
à
chacun
le
droit
de
respirer
un
air
qui
ne
nuise pas à sa santé.
Cette
loi
a
rendu
obligatoire
la
surveillance
de
la
qualité
de
l’air
(=>
création
de
AirParif),
la
définition
d’objectifs
de
qualité
et
l’information
du
public.
C’est
cette
même
loi
qui
a
instauré,
toujours
dans
l’objectif
de
respirer
un
air
qui
ne
nuise
pas
à
la
santé,
les
PDU
(Plan
de
Déplacement
Urbain) pour les agglomérations de plus de 100.000 habitants.
Elle a précédé les directives européennes
Le Conseil régional a adopté par délibération du 17 juin 2016 le plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021).
Comment connaître la pollution en temps réel
A
Montgeron,
un
capteur
d’Airparif
est
installé
2
rue
du
Presbytère
depuis
avril
1994
mais
il
ne
mesure
que
l’ozone
et
le
dioxyde
d’azote.
Il
ne
mesure pas les particules PM10 et PM2,5.
Une start-up parisienne, Plume Labs créée en 2014 par 2 ingénieurs anciens élèves de l’école polytechnique, a conçu un capteur individuel mobile.
Le premier modèle (129 €) permet de connaître en temps réel le niveau de pollution du lieu où l’on se trouve lorsque le capteur est connecté à un
smartphone.
Ce capteur mesure les particules PM2,5, PM10, le dioxyde d’azote
(NO2) et les composés organiques volatils (COV).
Cette société publie une carte de la pollution qui agrège les mesures des
utilisateurs de son capteur (plus de 200.000 dans le monde) et les
données publiques de la qualité de l’air, ici Airparif.
Cette carte éditée en temps réel (ci-contre celle du ) montre
régulièrement Montgeron et particulièrement la déviation de la RN6 en
orange, c’est-à-dire parmi les zones les plus polluées d’Île-de-France.
Que faire ?
La pollution importée par les vents, parfois de très loin, ne peut être
réduite par des mesures locales. Par contre, celle générée par le trafic
routier local peut être réduite si les élus prennent des mesures pour
réduire ledit trafic.
Ensuite, la plantation d’arbres en ville permet de réduire les concentrations en particules fines de 20 % à 50 % et d’offrir une diminution de
température de 0,5 °C et 2 °C selon un rapport de l’ONG Nature Conservancy,
DIMINUTION DU TRAFIC ROUTIER
Chaque
matin
de
chaque
jour
ouvré,
un
flux
important
de
véhicules
issus
d’autres
communes
transite
par
Montgeron
soit
pour
aller
vers
l’ouest,
Orly,
Rungis,
etc.
(flux
1)
soit
pour
aller
vers
le
nord
(flux
2)
en
contournant
le
bouchon
de
Villeneuve-Saint-Georges
(VSG)
par
le
plateau
de
Crosne,
soit
encore
pour
stationner
dans
les
parkings
Foch,
le
parking
de
Super
U
et
dans
les
rues
avoisinantes
qui
ne
sont
pas
en
zone
bleue
(flux
3).
A
ces
3
flux
s’ajoute
le
flux
des
véhicules
conduisant
les
enfants
à
l’école
(flux
4)
et
le
flux
5
des
véhicules
vers
les
commerces
et
les
surfaces
commerciales.
Les 4 premiers flux se superposent dans la même tranche horaire.
Comment réduire ces flux ?
Le flux 1 devrait normalement emprunter la déviation de la RN6 et ne pas transiter par le centre-ville. Un nouveau pont sur la Seine, s’il voit le
jour, devrait inciter à le faire. A défaut, une dissuasion, réglementaire ou autre, semble être la seule possibilité.
Le
flux
2
est
la
conséquence
de
la
non
réalisation
de
la
déviation
de
VSG
qui
aurait
dû
être
la
suite
de
la
déviation
de
Montgeron.
Il
créé
des
pertes
de
temps
pour
les
montgeronnais
qui
se
rendent
à
la
gare,
la
rue
du
Général
Leclerc
étant
totalement
congestionnée,
à
tel
point
que
les
passagers
des
bus
sont
parfois
amenés
à
descendre
avant
la
station
pour
ne
pas
rater
leur
train
sachant
qu’il
faut
parfois
10
minutes
pour
aller
de
la
mairie
à
la
gare.
Un
article
du
4
avril
2002
du
«
Parisien
»
mentionne
qu’un
projet
routier
de
7
km
a
été
retenu.
Il
reliait
le
Réveil-Matin
à
Montgeron
à
la
D60
(2x2
voies)
à
Valenton.
Il
respectait
l’environnement
et
les
habitants,
car
il
était
soit
en
souterrain
soit
en
tranchée
couverte.
Les
maires
des
différentes
communes et les présidents des deux conseils généraux concernés étaient d'accord selon l’article précité.
La
déviation
de
la
RN6
à
Villeneuve-Saint-Georges
qui
figurait
dans
le
SDRIF
1994
et
dans
le
projet
de SDRIF 2008 a disparu dans le SDRIF approuvé en décembre 2013 pour un horizon 2030.
S’il
avait
été
réalisé,
la
rue
du
Général
Leclerc
ne
supporterait
plus
qu’un
trafic
local
(quelques
rues
de
Crosne
aussi),
la
pollution
serait
diminuée
et
le
bouchon
de
VSG
lui-même,
sans
doute
un
mauvais
souvenir.
Cette
déviation
n’étant
pas
réalisable
à
horizon
visible,
une
solution
pour
permettre
aux
montgeronnais
d’aller
à
la
gare
confortablement,
rapidement
et
sans
subir
la
pollution,
serait
de
mettre
en
application
une
des
propositions
de
l’étude
ITER
(
voir
la
page
«
Schéma
des
circulations
douces»,
«Préconisations»
en
fin
de
page
)
à
savoir
le
boulevard
Sellier
en
zone
de
rencontre,
en
limitant
son
accès,
aux
riverains,
aux
piétons,
aux
cyclistes
et
aux
transports
en
commun
comme
des
navettes
électriques
de
petite taille.
Cette
solution
devrait
être
validée
et
précisée
dans
l’étude
à
venir
du
pôle
multimodal,
notamment
le
problème
de
la
rue
Louis
Armand
qui
devra
être
élargie.
Le
projet
de
maison
du
département
pourrait
avantageusement
être
établie
sur
la
maison
des
solidarités,
autre
structure
départementale
(sous utilisée) au lieu d’urbaniser un espace naturel comme la plaine de Chalandray.
Le
flux
3
pourrait
être
rapidement
réduit
en
limitant
la
capacité
des
parking
Foch
et
en
mettant
le
parking
de
Super
U
et
les
rues
avoisinantes
en
zone bleue.
Le
flux
4
ne
pourra
être
réduit
que
lorsqu’un
réseau
complet,
continu
et
totalement
sécurisé
de
pistes
cyclables
permettra
aux
parents
de
laisser
leurs enfants aller à l’école en vélo, sans appréhension.
Le
flux
5
pourra
être
réduit
par
une
campagne
de
sensibilisation
du
public
aux
conséquences
de
l’utilisation
de
son
véhicule
motorisé
pour
les
courses
de
proximité
tels
que
les
boulangeries
ou
les
commerces
de
bouche
et
par
un
affichage,
sur
les
panneaux
de
la
Ville,
de
la
pollution,
à
l’instar de la météo.

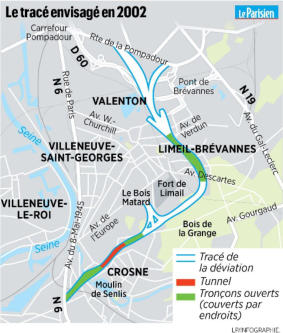
Page créée le 9 mai 2021